Un héritage des romains.
Selon un sondage, 94 % des Français mangent au moins une part de galette des rois pour l’Épiphanie. Cette fête chrétienne rappelle l’adoration du « divin enfant » par les « rois mages », Balthazar, Melchior et Gaspard. Apparue à la fin du IVe siècle, elle reprend en l’adaptant l’un des rites des Saturnales romaines durant lesquelles était tiré au sort le « roi » des festins. Inventée, semble-t-il, par des chanoines de Besançon au XIVe siècle, la galette des rois passa peu à peu aux chaumières[1].
De la fête familiale…

Greuze (1725-1805), La galette des rois 1774, Musée Fabre, Montpellier.
Sur ce tableau de Greuze [2], le père tient la galette découpée dans une serviette tandis que sur la table, au centre de la composition, est posée la part du « pauvre » dite aussi « part à Dieu ». En dehors de ce geste, rien ne laisse deviner une fête religieuse. Greuze a représenté l’image d’un moment familial simple et joyeux. Les enfants montrent leur impatience enfantine : qui aura la fève ?
À une possible « débauche » ?
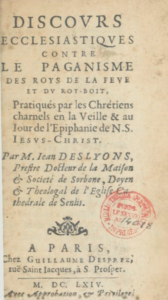
Frontispice de l’ouvrage de l’abbé Deslyons. Source, Gallica.
Mais si l’on en croit les chroniqueurs du 17e et 18e, la célébration des Rois, loin de ce tableau champêtre, donnait lieu à des errements contraires aux bonnes mœurs. En 1664, dans son « Discours ecclésiastique contre le paganisme du roi boit », L’abbé Deslyons fustige « cette maudite et diabolique coutume de païen » qui entrainait « débauche et concupiscence ». Voici qui nous amène tout droit à une histoire rapportée par le folkloriste chartrain Lecocq en 1867. Les « faits » se seraient déroulés le samedi 6 janvier 1725, jour de l’Épiphanie dans le faubourg Saint-Brice[3].
Galette et danse au son du violon
À la suite de la veillée, huit garçons et huit filles avaient décidé de célébrer l’Épiphanie. Aux garçons les frais du vin, aux filles ceux de la galette, laquelle fut découpée en dix-sept portions pour respecter la coutume de la « part à Dieu ». Puis, on songea que la fête serait plus réussie si l’on pouvait danser au son du violon. La nommée Marie Doublet s’opposa à cette idée, objectant qu’elle portait le deuil de sa mère. Elle invita ses cousines – qui avaient perdu leur tante – à suivre son exemple. En pure perte. Trois garçons et trois jeunes filles, bras dessus bras dessous, prirent le chemin de la ville, pensant débaucher par un écu de trois livres un violoneux qui logeait rue Serpente. Mais il était 23 heures. La porte Michel était fermée et, comble de malchance, le fil de la sonnette du portier était rompu…

D’après le plan de Chartres en 1750. La ville encore entourée par une enceinte percée de neuf portes. Source : Les fortifications de Chartres, article de Louis Bonnard in Tome XVI (1923-1936) Mémoires de la Société archéologique d’Eure-et-Loir p. 257-320.
Le violoneux de Saint-Brice
Comme ils revenaient sur leur pas, les six jeunes gens passèrent devant un inconnu couvert d’un tricorne et d’allure étrange. Heureux hasard, il tenait sous son bras un sac contenant un violon. Aubaine supplémentaire, il n’exigeait aucune pièce pour sa prestation en échange du gite pour le reste de la nuit. Le retour à la cave se fit au milieu des cris de joie et de bruyants éclats de rire. Le ménétrier accepta volontiers plusieurs verres de vin, mais quand les jeunes filles lui présentèrent la part de la galette dite « part à Dieu », il eut un haut-le-cœur, donnant pour excuse qu’il digérait péniblement.
Danses échevelées, danses endiablées

Le violoneux, son violon, son tricorne et les danseurs. Source : gravure extraite du livre de Lecocq, Chroniques, légendes, curiosités et biographies beauceronnes p.79.
De sa main gauche, il saisit prestement l’archet. La danse commença. Bientôt, raconte Lecocq, « la gaité fut à son comble. Aux branles entrainants succédaient les menuets et rigodons les mieux cadencés, puis des danses échevelées ; dans certains moments où ces jeunes fous exécutaient des rondes, on eut dit un violent tourbillon entrainé par la tempête […] tous semblaient emportés dans l’espace par une puissance surnaturelle ».
Seule sur sa chaise, Marie Doublet observait, affligée, ces farandoles infernales orchestrées par le ménétrier. Soudain, elle remarqua que son chapeau, emporté par le mouvement, avait bougé : du sommet de son front pointaient deux petites cornes. Le démon !
Galette sauvée par le Capucin

Capucin, 1811. Auteur anonyme. Source wikipédia.
Aussitôt, elle courut chercher l’assistance d’un Capucin[4]. Muni d’un rituel, ils se transporta dans la cave et récita les prières de l’exorcisme. Alors, conclut Lecocq, « une lumière vive, accompagnée d’une fumée âcre et d’une puanteur extrême se répandit dans toute la cave. Un cri aigu et terrifiant se fit entendre. Puis l’odeur se dissipa et tout rentra sans le silence. Ce fut alors un étrange spectacle d’apercevoir ces filles et ces garçons, au regard hébété, semblant se réveiller d’un songe pénible ». À la messe du dimanche, le curé de la paroisse chapitra les fidèles qui ne respectaient pas les morts et tança les femmes : « La modestie – bouclier le plus salutaire contre les œuvres du démon – n’existait plus. Avec leurs chevelures ébouriffées et si démesurées, elles semblaient renier la pudeur… »
Vertus d’une histoire édifiante
Relancé par Lecocq dans un XIXe siècle très moralisateur, ce conte du XVIIIe siècle s’inscrit dans la lutte séculaire de l’Eglise pour régenter les loisirs et en particulier les danses, propices à tous les débordements[5].

Louis-Léopold Boilly (1761-1845). Le Songe de Tartini, 1824. Le violoniste aurait retranscrit les notes virtuoses jouées par le diable et entendues pendant un songe. D’où la Sonate des trilles du Diable. Source : BNF.
Il reprend également deux représentations du temps : d’une part, le violon comme instrument préféré du diable, justement à partir du XVIIIe siècle ; et d’autre part la virtuosité du jeu d’archet – le « rythme endiablé » -, associée au Mal. En obligeant hommes et femmes à gambiller jusqu’à épuisement complet, le diable de notre histoire les délie des forces de l’âme[6].
La galette de Beauce : Fébé Domine, pour qui ?
Quittons le violoneux de Saint-Brice pour revenir à la galette de Beauce à la fin du XIXe siècle telle qu’elle nous est servie par le folkloriste Marcel-Robillard[7]. Dégustée en famille ou à l’occasion de réunions associatives, elle était l’apanage des boulangers qui furent longtemps tenu d’offrir une part à leurs clients. « D’une dimension moyenne à celle d’une roue de bérouette, elle était faite de paille feuilletée, bien levée. Ni sucrée ni fourrée, elle portait des traits croisés en losange tracés à la pointe du couteau ». L’aïeul ou la maitresse de maison invitait un enfant à se mettre sous la table, puis disait : « Fébé Domine [Seigneur de la fève] pour qui ? ». L’enfant désignait par ordre d’âge les femmes puis les hommes. Le détenteur de la fève choisissait son roi ou sa reine. Venaient les acclamations : « Le roi boit, Vive le roi ».

Luigi Loir (1845-1916), La galette des rois en famille.
Aux enfants, « la part à Dieu », sinon…
En Beauce, la coutume voulait que les enfants des campagnes aillent de porte en porte pour recevoir la fameuse « part à Dieu ». Il leur fallait toutefois chanter quelques couplets. En voici un extrait :
À l’entrée de votre souper
S’il y a une part de galette
Je vous prie de nous la donner
Puis nous accorderons nos voix
Bergers, bergères
Pour chanter les rois

Si la porte demeurait close, les gamins n’invoquaient pas le démon, ni ne dansaient la gigue… mais chantonnaient deux vers à la promesse très concrète :
Si vous n’voulez pas donner
À vot’ port nous allons pisser
Notes
[1] Gérard Boutet, la France en héritage, Perrin, 2007, p. 568.
[2] Greuze : la galette des rois 1774, lieu de conservation Musée Fabre Montpellier
[3] Lecocq, chroniques, légendes et curiosités, biographies beauceronnes, Chartres Petrot Garnier 1867, p 69-85.
[4] Le choix des Capucins n’est pas anodin : à l’encontre de la mode baroque, ils adoptèrent une liturgie dite « lugubre », sans aucun instrument de musique.
[5] Le lien entre musique et péché est très présent dans la mentalité chrétienne. Depuis le Moyen Age, les musiciens ambulants étaient suspectés d’introduire le vice dans les âmes et d’être des agents du démon.
[6] Tartini, célèbre violoniste et compositeur de cette époque, aurait vu en songe le Diable jouant du violon avec une prodigieuse virtuosité. Il aurait retranscrit la musique entendue dans sa sonate, le Trille du diable. A ce sujet, Nigel Wilkins, La musique du diable, Éditions Mardaga, 1999.
[7] Marcel-Robillard, Le folklore de la Beauce Volume 11, Maisonneuve et Larose, p. 141.

Toujours très intéressant. Dans l’extrait de Marcel Robillard cité à la fin, j’ai retrouvé ce mot de « bérouette » employé par ma grand-mère née en 1892 et native de Dreux.
Merci pour vos articles que je lis à chaque fois.